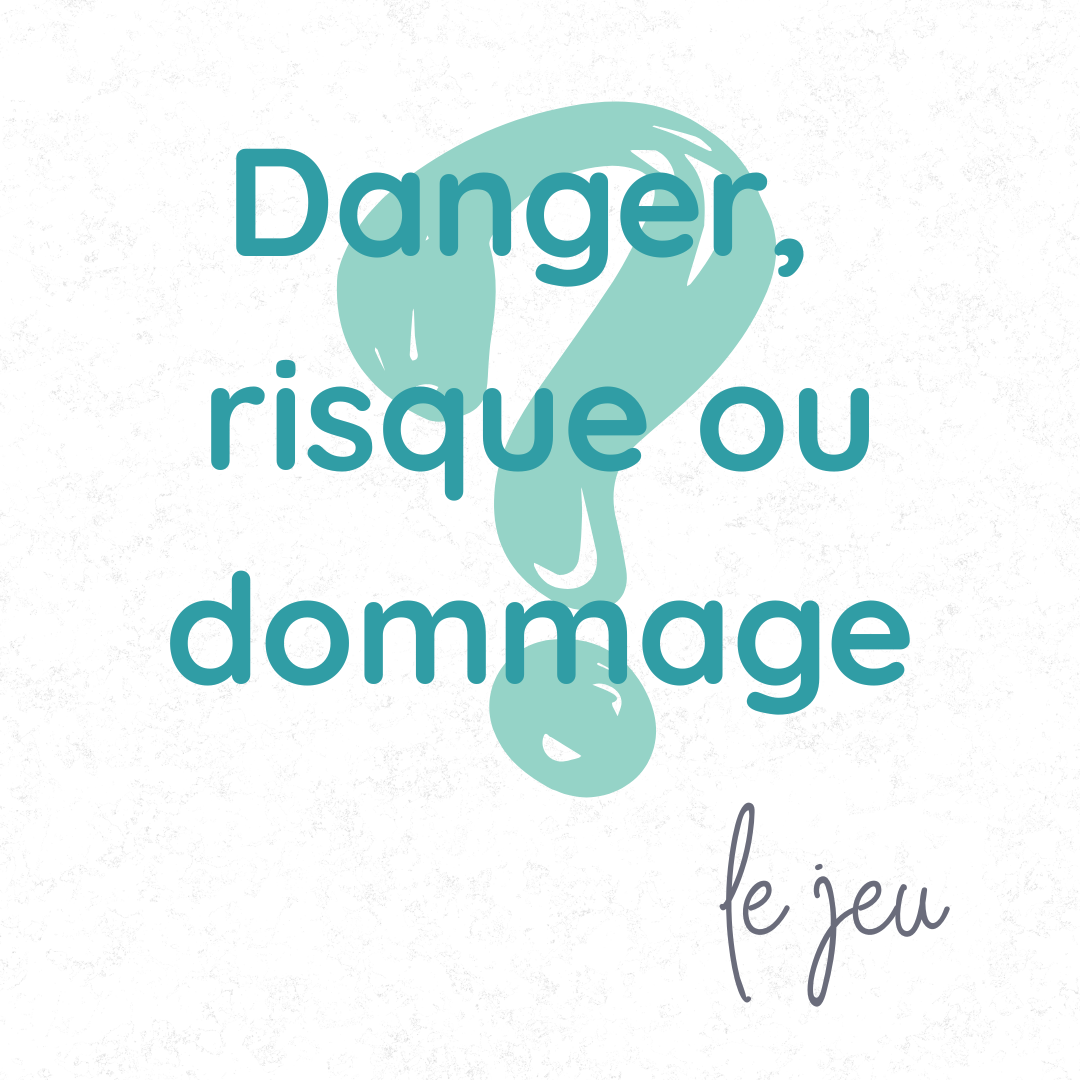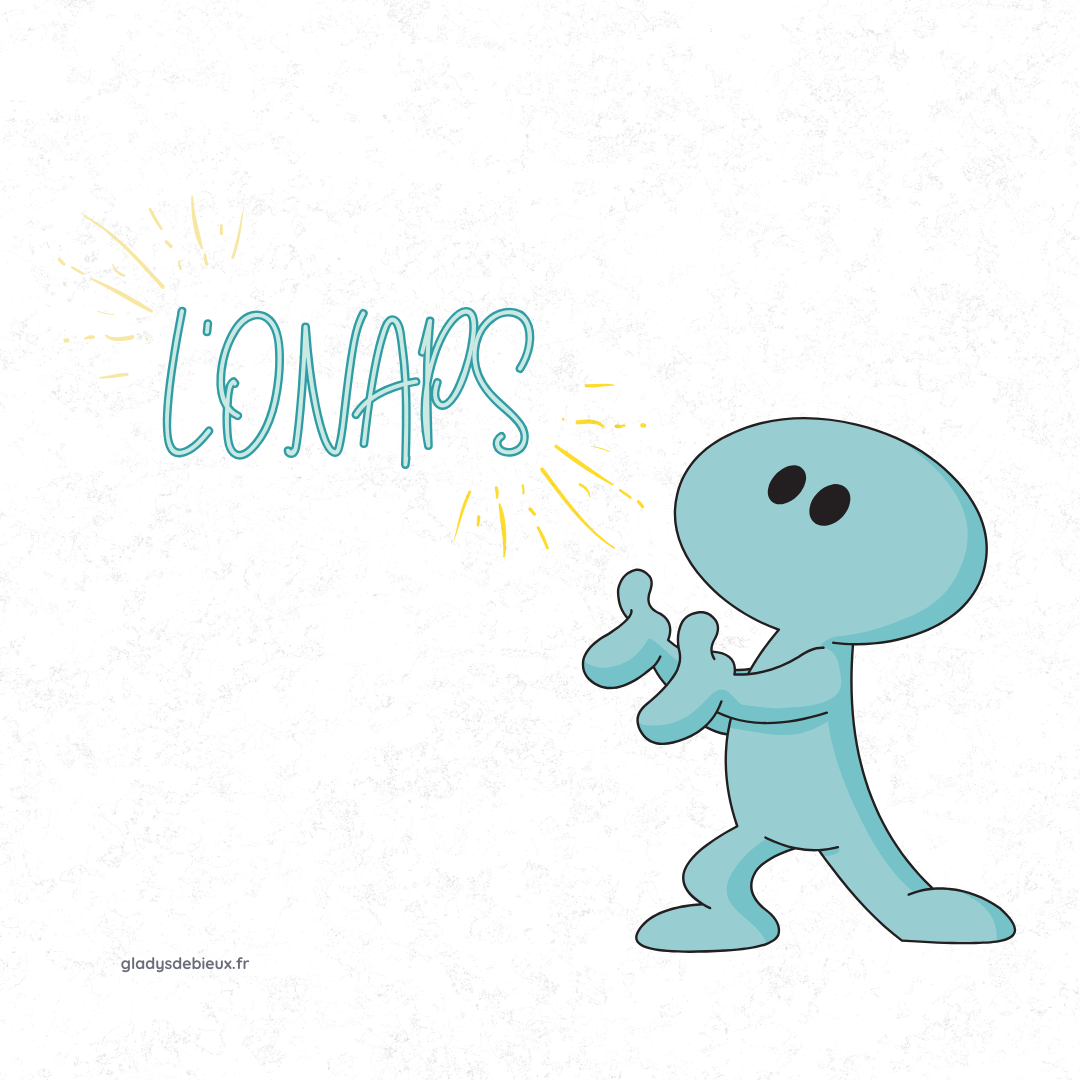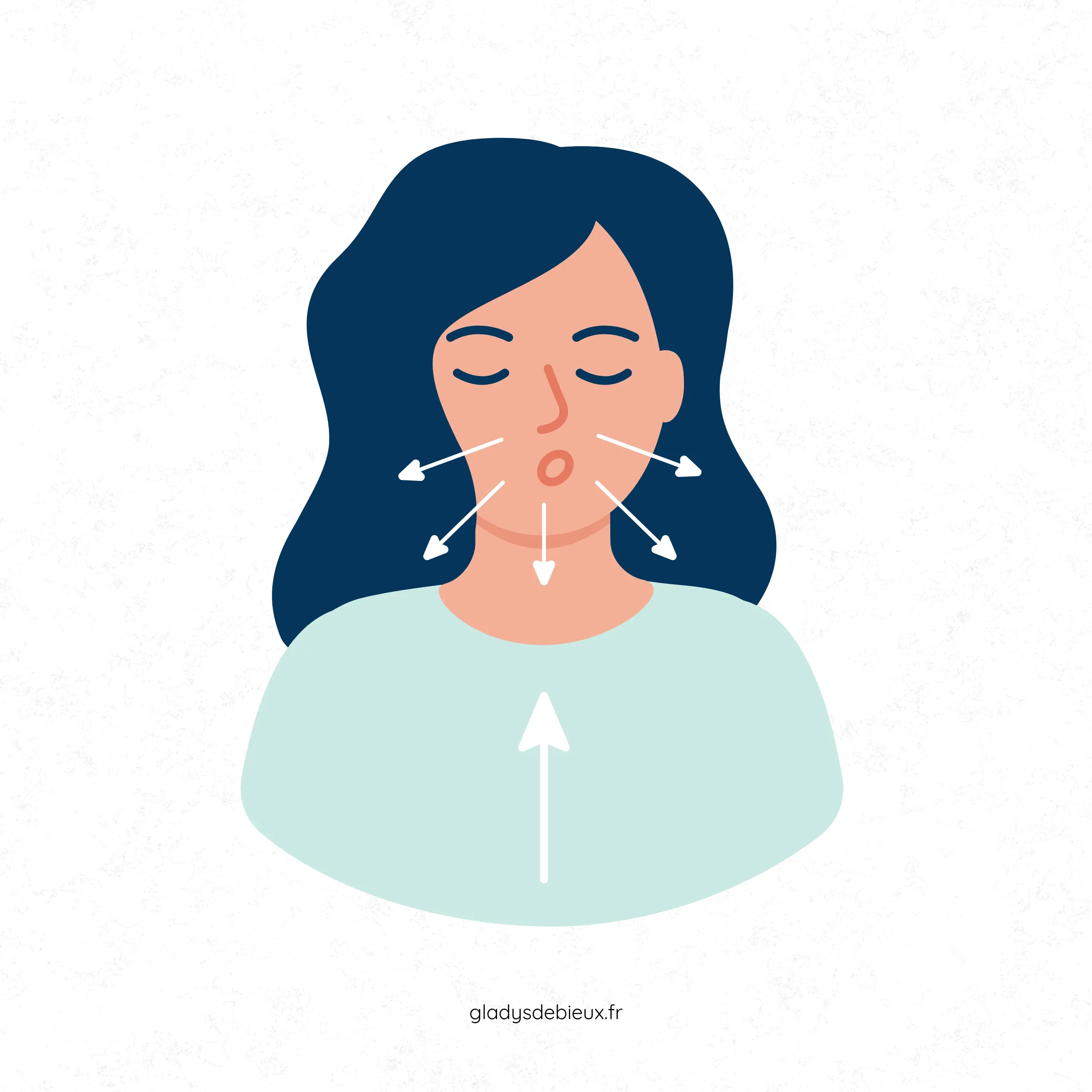Quand on parle de santé et sécurité au travail, deux mots reviennent très souvent : danger et risque. Ils sont parfois confondus, alors qu’ils ont des significations bien distinctes. Comprendre leur différence constitue la première brique d’un édifice solide de prévention. Prenons un instant pour clarifier ces notions.

Références
Cet article s’appuie sur les définitions officielles de :
– l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité),
– l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
Le danger : ce qui peut faire du mal
Le danger, c’est ce qui a le potentiel de nuire. C’est une propriété propre à un objet, un produit, un environnement ou une situation. Autrement dit, c’est la « matière première » du problème potentiel.
Imaginez un lion 🦁. Par nature, un lion est dangereux : il a des griffes, des crocs, et une force impressionnante. Même s’il dort, il reste potentiellement dangereux.
Dans le travail, c’est pareil :
- Une machine avec des lames coupantes est un danger.
- Un sol mouillé est un danger.
- Un produit chimique irritant est un danger.
👉 Ces dangers existent, même si rien ne s’est encore produit. Ils sont des sources potentielles de dommages pour la santé ou la sécurité des personnes.
Selon l’INRS :
Le danger au travail est « la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, produit, méthode de travail ou situation à causer un dommage ».
Le danger, c’est :
- Tout ce qui possède un potentiel de nuisance,
- Ce qui peut faire du mal même si rien ne s’est encore produit,
- Différent d’une menace, qui implique une intention ou un acte malveillant.

Le risque : la probabilité que ça vous arrive
Le risque, c’est la combinaison de deux éléments :
- la probabilité d’être exposé au danger,
- et la gravité des conséquences si cela se produit.
Autrement dit, le risque, c’est le scénario où le danger se transforme en accident ou en problème de santé.
Reprenons l’exemple du lion :
- Si vous habitez en Seine-et-Marne, le danger existe (un lion peut mordre !), mais le risque est quasiment nul : il n’y a pas de lions qui se promènent dans les rues 😉.
- Si vous travaillez dans un zoo, le danger est bien réel : les lions sont là, dans leur enclos. Mais si vous suivez les règles de sécurité, le risque reste très faible.
- Si vous vivez en Afrique du Sud, près d’une réserve naturelle, le risque devient plus concret. Il y a toujours des mesures de protection, mais la probabilité de croiser un lion est plus élevée qu’en France.
Prenons des exemples au travail :
- Se couper avec une machine mal sécurisée
→ Danger : la lame tranchante
→ Risque : se blesser si la protection est défaillante ou mal utilisée
Inhaler des vapeurs toxiques sans masque
→ Danger : le produit chimique
→ Risque : développer une intoxication si l’on travaille sans protection
Glisser sur un sol mouillé non signalé
→ Danger : le sol humide
→ Risque : chuter si aucun panneau d’avertissement n’est installé
L’existence d’un danger ne signifie pas forcément qu’il y a un risque.
Par exemple, un câble électrique sous tension représente bien un danger (le courant électrique peut provoquer des dommages graves à partir d’une certaine intensité).
Mais si ce câble est correctement isolé, une personne qui travaille à proximité n’est pas exposée : dans ce cas, le danger est présent, mais il n’y a pas de risque d’électrocution.
De la même manière, lorsqu’on parle de risque, on parle d’une probabilité : le fait qu’un risque existe ne veut pas dire qu’un accident va forcément se produire. Cela signifie simplement qu’il y a une chance, plus ou moins grande, que cela arrive.
📌 Le risque se définit donc comme la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement dangereux et de l’impact de ses conséquences.
Le dommage : quand le risque devient réel
Le dommage, c’est la blessure, la brûlure, la chute, l’intoxication et/ou la maladie qui résulte de l’exposition à un danger. C’est donc ce qui arrive si le risque se matérialise.
C’est la conséquence concrète et le préjudice réel que la personne subit. En clair, c’est le pépin, le vrai. Et c’est ce que l’on cherche à éviter.
Exemple dans un supermarché :
- Un employé nettoie le sol : il devient glissant.
- Il oublie de mettre un panneau de signalisation.
- Une collègue passe, glisse et tombe → entorse à la cheville
→ Danger : ce qui peut faire du mal ⇒ le sol mouillé
→ Risque : la probabilité que ça arrive vraiment ⇒ la possibilité de chute si rien ne prévient les passants
→ Dommage : conséquence si le risque s’est produit suite à l’exposition à un danger ⇒ l’entorse consécutive à la chute
L’existence d’un danger ne signifie pas forcément qu’il y a un risque.
Par exemple, un câble électrique sous tension représente bien un danger (le courant électrique peut provoquer des dommages graves à partir d’une certaine intensité).
Mais si ce câble est correctement isolé, une personne qui travaille à proximité n’est pas exposée : dans ce cas, le danger est présent, mais il n’y a pas de risque d’électrocution.
Ainsi quand on parle de risque, on parle d’une probabilité : le fait qu’un danger, ni même qu’un risque existe ne veut pas dire qu’un accident va forcément se produire.
📌 Le risque dépend non seulement du danger, mais aussi de la manière et de la durée d’exposition.
Pourquoi distinguer ces termes ?
Parce que la prévention des risques professionnels améliore la santé au travail… et peut même sauver des vies.
Chaque année, les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un coût humain énorme, sans parler des conséquences pour les entreprises : absentéisme, démotivation, perte de compétences, tensions dans les équipes… (Source : ANACT, INRS).
Prévenir les risques, c’est aussi favoriser un meilleur climat social et renforcer la performance collective. Tout le monde y gagne.
Mais pour agir efficacement, il faut d’abord bien comprendre la différence entre danger et risque.
Pourquoi ?
Parce que ce que nous voulons éviter, ce sont les dommages : blessures, maladies, stress chronique… Et pour cela, il faut éliminer ou réduire les risques, pas juste se focaliser sur les dangers.
Parfois, il est impossible de supprimer un danger. Mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire.
Rappelez-vous : le problème, ce n’est pas uniquement le danger, c’est l’exposition à ce danger. C’est cette exposition, ponctuelle ou prolongée, qui crée le risque… et donc le dommage potentiel.
Autrement dit : même si vous ne pouvez pas empêcher le lion d’exister 🦁, vous pouvez éviter de mettre la main, et même pire, la tête dans sa gueule !
En santé et sécurité au travail, c’est pareil. On agit toujours là où on peut, mais on agit. Et souvent, il est possible de mettre en place des mesures pour éliminer ou au minimum réduire les risques professionnels :
- réorganiser le travail,
- adapter l’équipement,
- former les salariés,
- améliorer la signalétique,
- mettre en place des protections collectives et/ou individuelles…
La bonne nouvelle, c’est qu’on peut réduire les risques, même si on ne peut pas toujours faire disparaître tous les dangers. Un peu comme marcher sous la pluie : on ne peut pas arrêter le nuage ☁️, mais on peut ouvrir le parapluie ☔.
📌 Ne pas pouvoir supprimer un danger ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire !
Concrètement, comment agir ?
Dans un contexte professionnel, la détection des risques est une démarche préventive essentielle pour identifier, évaluer et maîtriser ces risques afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Voici un chemin en quatre étapes, recommandé par l’INRS :
- Identifier les dangers : ce qui peut nuire (bruit, outil, produit…)
- Évaluer les risques : à quelle fréquence ? Quelle gravité possible ?
- Mettre en place des actions de prévention : formation, EPI (Equipement de Protection Individuelle), signalétique, organisation.
- Réévaluer régulièrement : les situations changent, les risques aussi.
📝 Cette démarche est formalisée dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), obligatoire pour toute entreprise dès l’embauche du premier salarié.

En résumé
✅ Le danger, c’est ce qui a le potentiel de nuire.
✅ Le risque, c’est la probabilité que ça arrive, selon le contexte et la gravité des conséquences.
✅ Le dommage, c’est la conséquence si le risque devient réalité.
💬 Et dans votre quotidien professionnel, comment distinguez-vous danger et risque ?
Avez-vous des exemples concrets en tête, ou des situations où cette différence vous a semblé importante à clarifier ?
Vous pouvez partager vos expériences ou vos questions en commentaire. Cela peut nourrir la réflexion commune.
Sources
- Qu’est-ce qu’un risque professionnel ? – fontion publique.gouv
- Evaluation des risques professionnels : de quoi parle-t-on ? – INRS
- L’évaluation des riques professionnels – guide INRS
- Fondamentaux en prévention – démarches de prévention – INRS
- Les risques professionnels et les outils pour les maîtriser – les pros de la petite enfance
- Le Document unique d’évaluation des risques professionnels et les actions de prévention : Principales définitions – Ministère de la transformation et de la fonction publiques